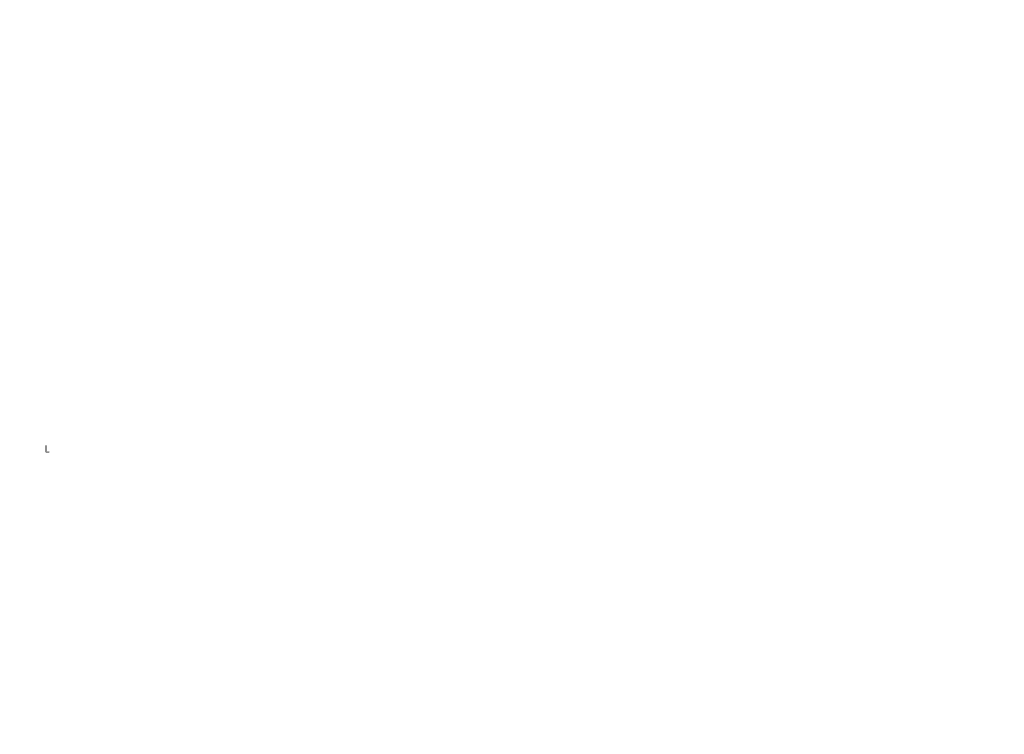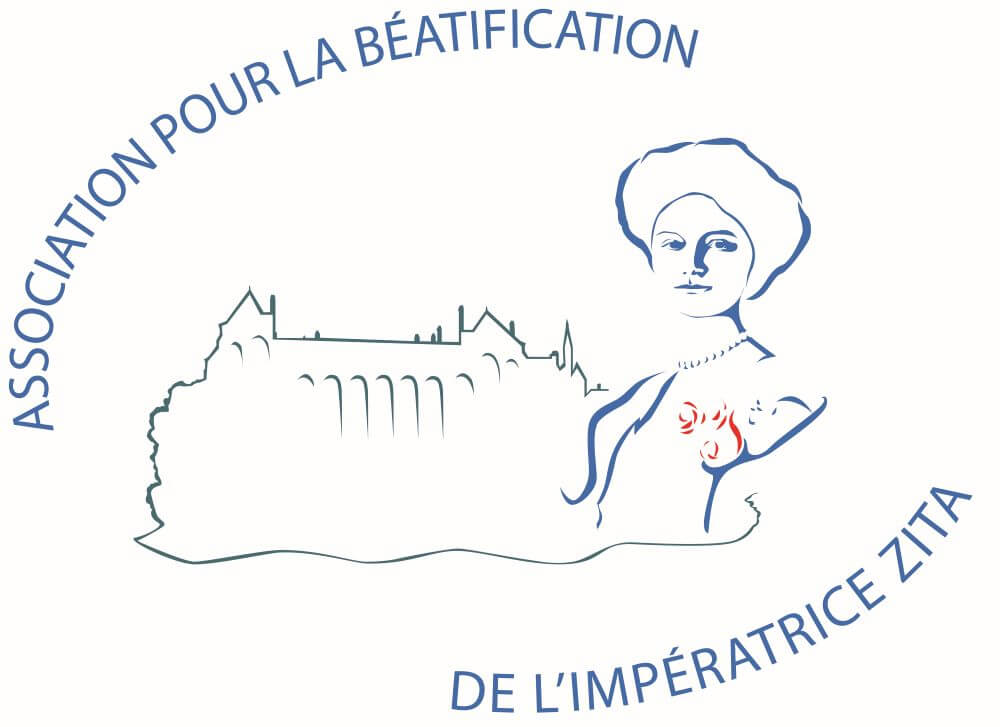Le 13 avril 2003, Jean-Paul II déclare Charles vénérable et publie le décret proclamant l’héroïcité de ses vertus :
« Il était un homme d’une intégrité morale certaine et d’une foi solide, qui a toujours cherché le mieux pour ses peuples, et dans ses actes de gouvernement s’est conformé à la doctrine sociale de l’Église. Il a entretenu les idéaux de justice et de paix avec un appel constant à la sainteté. Il était un chrétien, un mari, un père, un monarque exemplaire. »
Jean-Paul II
Le 3 octobre 2004, le pape Saint Jean-Paul II a proclamé bienheureux l’empereur Charles d’Autriche, avec quatre autres serviteurs de Dieu et a déclaré dans son homélie :
« Le devoir décisif du chrétien consiste à chercher en toute chose la volonté de Dieu, à la reconnaître et à la suivre. L’homme d’État et le chrétien Charles d’Autriche se fixa quotidiennement ce défi. Il était un ami de la paix. À ses yeux, la guerre apparaissait comme « une chose horrible ». Arrivé au pouvoir dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, il tenta de promouvoir l’initiative de paix de mon prédécesseur Benoît XV.
Dès le début, l’empereur Charles conçut sa charge comme un service saint à ses sujets. Sa principale préoccupation était de suivre la vocation du chrétien à la sainteté[1] également dans son action politique. Par conséquent, il était important, pour lui, que l’amour du prochain soit traduit dans les lois sociales. Qu’il soit un exemple pour nous tous, en particulier pour ceux qui ont aujourd’hui une responsabilité politique en Europe[2] ! »
Jean-Paul II
[1]. Saint Jean-Paul II, Message pour la XXXIXe Journée mondiale de prière pour les vocations, 21 avril 2022.
Les vertus privées de chrétien, époux et père de famille n’empêchent pas les vertus politiques de Charles. C’est le sens des paroles de saint Jean-Paul II le lendemain 4 octobre lors de la messe d’action de grâce :
« Charles d’Autriche voulut toujours être au service de la volonté de Dieu. La foi fut le critère de sa responsabilité de souverain et de père de famille. À son exemple, que la foi en Dieu détermine l’orientation de votre vie ! Que les bienheureux vous accompagnent tout au long de votre pèlerinage vers la maison céleste. »
Jean-Paul II
Le 11 mai 2022, l’année du Centenaire de la mort du Bx Charles, Monseigneur Nuno Bràs, évêque de Funchal (Madère) a déclaré que le Bienheureux Charles sera « le saint patron des Journées mondiales de la jeunesse dans notre diocèse…, car le Bienheureux Charles était un jeune homme qui a assumé la mission que Dieu lui a confiée et un jeune homme qui est un exemple pour chacun d’entre nous[1] ».
La fête liturgique du Bienheureux Charles est fixée le 21 octobre, jour de son mariage avec Zita et non le 1er avril, jour de son retour au Père, comme c’est la tradition dans l’Eglise.
Vers la canonisation de l'empereur Charles
Depuis 1949, l’acteur de la cause de béatification et, depuis 2004, de canonisation du bienheureux Charles, est une association autrichienne dénommée : Gebetsliga für den Völkerfrieden (ligue de prière pour la paix entre les peuples ; en abrégé : Gebetsliga / Ligue de prière).
Cette association est représentée en France par Madame Elizabeth Montfort (secrétaire de l’association française pour la béatification et la canonisation de l’Impératrice Zita) et publie régulièrement des informations sur le site :
https://bienheureuxcharlesdautriche.com
Chaque année, la Ligue de Prière organise en France une messe le 1er avril, date de la mort du Bienheureux Charles, et une messe le 21 octobre, jour de sa fête liturgique.